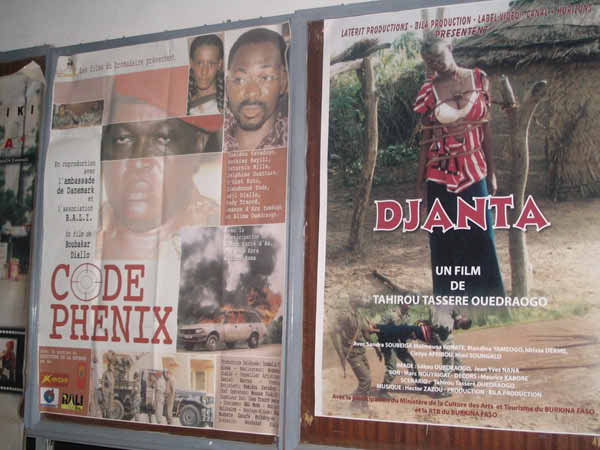
En 2007, cela fait presque 47 ans que plusieurs pays d’Afrique noire ont acquis leurs indépendances. A ce jour, aucun Etat n’a réussi à asseoir une véritable politique de développement de l’industrie cinématographique. Et pourtant, ce ne sont pas des déclarations d’intention et d’engagement politiques qui ont manqué. Toutes les tentatives de sortie de crise initiées autour des regroupements régionaux et sous-régionaux comme l’Union Africaine, (UA), l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, (UEMOA), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)…n’ont pas abouti. Pourquoi les dirigeants africains n’arrivent-ils pas véritablement à concevoir et exécuter une politique de développement conséquente en matière de cinéma ?
La réussite de la politique du développement de l’industrie cinématographique américaine et notamment française, l’exemple qu’elle représente aujourd’hui dans le monde, ne tient pas d’un quelconque miracle, mais d’une volonté politique et d’un environnement socio-économique favorable. Dès son apparition en 1895 en France, grâce aux Frères Lumières, le cinéma fut accueilli par la Société d’Encouragement à l’Industrie Nationale. Ce fut le début de l’exploitation et de la distribution cinématographiques. Dès lors, le cinéma devint dans plusieurs pays d’Europe (Allemagne, Angleterre, Danemark, France, Italie, Suède…), le nouveau phénomène de masse. Des créateurs de génie, des entrepreneurs, lui donnèrent un élan commercial en installant des maisons de production, des salles d’exploitation, des entreprises de distribution, des usines de fabrication de matériel cinématographique, des laboratoires. Le cinéma connut son essor artistique grâce à la grande vogue du théâtre filmé, aux adaptations d’œuvres littéraires, aux cinés romans et aux films comiques. A partir de 1919, la critique cinématographique fit son apparition. Bon nombre de personnalités du monde littéraire et artistique s’intéressèrent au cinéma. Des revues et magazines spécialisés, des ciné-clubs, des sociétés d’auteurs, des salles spécialisées virent le jour. A la veille de la première guerre mondiale, on comptait environ 15 700 salles en Amérique, 4 500 en Angleterre, 3 000 salles environ en Italie, 2 500 en Allemagne, 1 200 en France, 900 en Espagne, 775 en Belgique, 100 au Portugal. A partir de 1925, le cinéma asiatique (chinois, hindou et japonais notamment) prit son envol.
Le cinéma fut introduit en Afrique entre 1896 et 1918, à des fins de conquêtes coloniales par des industriels, des missionnaires, des administrateurs et des commerçants européens. Avec les indépendances, les nouveaux dirigeants africains vont utiliser le cinéma à d’autres fins. En 1960, Patrice Emery Lumumba, Premier Ministre du République Démocratique du Congo (Ex Zaïre) déclarait que le cinéma est appelé à jouer un rôle important dans le domaine de l’éducation intellectuelle et même politique des peuples. Sembene Ousmane, cinéaste sénégalais, disait quant à lui, « qu’en ce qui concerne les cinéastes africains, il y a un problème de militantisme, un désir, ne disons pas de dialogue, ce serait unilatéral, mais de faire prendre conscience à leur peuple du poids de sa culture et de sa responsabilité. Pour moi, c’est très simple : le cinéma est une école du soir pour nous. Il faut que le cinéma soit un élément qui permette à tous les spectateurs, à tous les africains de s’identifier … ». Il est évident que beaucoup de cinéastes et hommes politiques africains furent pénétrés par des convictions de ce genre.
Le cinéma africain est né presque la même année (1963) que l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). C’est en réalité à partir de cette date qu’a commencé véritablement la lutte des africains pour imposer leur cinéma sur leurs propres écrans. C’est de là qu’est née la rivalité avec les compagnies étrangères qui contrôlent le marché du cinéma en Afrique, qui ne sont pas d’avis que ce cinéma de moindre qualité ne vienne empiéter sur leur marché.
Le seul souci qui guidait les cinéastes africains dans ces années, regroupés derrière la Fédération Panafricaine des Cinéastes (FEPACI), quand ils se retrouvaient dans des festivals à Vienne, dans des colloques à Alger, Dakar, Tunis, Ouagadougou, était de réfléchir sur l’avenir du cinéma africain particulièrement. La FEPACI réunit 33 pays du continent et avait pour credo, d’inciter auprès des gouvernants africains pour qu’ils prennent des mesures protectionnistes qui s’imposaient pour la survie du cinéma naissant. Cette dynamique connut un succès mitigé au début des années 70, car quelques pays de l’Afrique noire francophone réussirent à implanter un embryon d’industrie cinématographique, en entretenant un nombre assez modeste de salles, un circuit de distribution et une production nationale relativement importante (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal).
Les années 80 marquèrent une nouvelle étape de l’histoire du cinéma en Afrique. La production hausse, la distribution s’organise, les salles se nationalisent au profit d’exploitants africains. Les cinémas des pays lusophones et anglophones, Angola, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, sont en marchent.
Malgré ces efforts, le cinéma africain ne se rentabilise pas, non seulement en Afrique mais aussi hors du continent. Et pourtant, les possibilités de sa production selon les règles de l’art existent. Les cinéastes africains vivent alors dans le doute. Les propos de Tahar Cheriaa, cinéaste tunisien, sont révélateurs « … j’ai un peu l’impression d’être quelqu’un dont les propres idées sont fatiguées, qui est lui-même las d’avoir à reprendre constamment les mêmes faits, la même analyse et à avoir aussi, en dépit des efforts, cette impression assez pénible, assez lassante de voir que la situation, ne change pas ».
Le fait de n’avoir pas donner des signes positifs aux cinéastes africains, les hommes politiques ont plongé le cinéma dans un dilemme. Le cinéma, comme disait l’autre, est une industrie. On devrait suivre la même démarche utilisée pour la réalisation des autres industries à travers un processus englobant la conception, la fabrication, la commercialisation et la consommation. C’est un produit offert par les uns pour répondre à la demande des autres. C’est par ce processus, par ce biais, qu’il faut essayer de chercher le pourquoi de cette spécificité, de cette anomalie du cinéma en Afrique et se demander comment arriver peut-être espérer le voir rejoindre un destin similaire à celui des autres cinématographies.
Le cinéma en Afrique noire était mal parti. La problématique du marché qui le sous-tendait était mal posée par les cinéastes. Les structures qui devront permettre au film d’être demandé et d’être convoité comme n’importe quel produit n’avaient pas été bien exploités. A l’époque, le système qui régentait le marché du cinéma en Afrique noire, était considéré comme colonial et impérialiste et les cinéastes ne croyaient pas que, de la bonne santé de celui-ci, dépendait la survie de leur cinéma. L’exemple pris par Tahar Cheriaa, sur la Tunisie , qui est un pays africain où le cinéma est soutenu par l’Etat, illustre la philosophie réelle que le cinéma africain aurait du adapter : « Un pays comme la Tunisie ne pourrait jamais rentabiliser pour quiconque, pour l’Etat Tunisien, pour Gaumont ou tout autre distributeur, rentabiliser le volume de films dont les Tunisiens ont besoin et l’ensemble de films qu’ils consomment quotidiennement, c’est-à-dire les acheter à l’étranger et en retirer un bénéfice minimal, ne serait-ce que de 2 ou 3% par rapport au capital investi, s’il ne le fait qu’à l’intérieur de la Tunisie. Pourquoi ? Parce qu’il y a suffisamment de consommateurs qui demandent, mais il n’y a pas suffisamment de points de projection, de salles, donc de recettes pour faire face au prix de revient si la Tunisie achetait toute seule à l’intérieur de ses frontières. Elle a besoin de faire alliance avec d’autres utilisateurs du film pour essayer d’équilibrer ses dépenses d’achats avec les recettes » . Cet exemple est valable pour l’ensemble des pays africains.
Les cinéastes algériens semblaient réussir leur pari en décrétant un monopole national d’importation de films en 1971, obligeant la Motion Pictures Export Association of América (MPEAA), à se plier à leurs conditions. Cette expérience fera tache d’huile. Ces tentatives de nationalisation d’importation et d’exploitation des films en Afrique malgré leurs extension à d’autres pays ne connaîtront pas de grand succès, puisque boycotter par les grandes compagnies étrangères regroupées en puissants trusts.
Au festival de Carthage à Tunis en 1974, il y eut le premier Colloque sur la production et la distribution du film en Afrique, ayant réunit les nouveaux dirigeants des sociétés nationales de cinéma. Ces derniers concluent de la nécessité de regrouper les marchés cinématographiques africains pour assurer une rentabilisation des films locaux, rentabilisation devenue impossible si elle était faite isolement vu l’insuffisance du nombre de salles que chaque Etat disposait.
Face à cette nouvelle donne, les compagnies étrangères notamment la MPEAA , et l’Union Générale Cinématographique (UGC), changèrent leur approche et trouvèrent une entente avec les cinéastes africains. Celle-ci s’était concrétisée par la signature d’accords qui donnaient une place au cinéma africain.
Conséquemment à l’application de ces accords, les salles appartenant aux compagnies étrangères ont été vendues aux entrepreneurs locaux. Mais, ces compagnies étrangères continuaient toujours de monopoliser l’importation-distribution des films américains, chinois et indiens, qui battaient tous les recors d’entrées et occupaient 99,98% de part du marché. Le mouvement de récupération par les africains des salles va s’opérer un peu partout sur le continent. Les cinéastes africains créèrent une nouvelle structure dénommée « Consortium Interafricain de distribution cinématographique » (CIDC), une sorte de marché commun de distribution cinématographique regroupant 14 pays de l’Afrique francophone, c’était en 1979. Le CIDC ne réussit pas à se maintenir vivant pendant longtemps. Il connut une grave crise en 1984, qui entraîna sa disparition.
Après plus d’une décennie d’essai et de tâtonnement, les cinéastes et les hommes politiques africains se rendent compte de la grave erreur qu’ils avaient commise en nationalisant intégralement les salles. Les gouvernants africains, pensaient aussi relever leurs économies en taxant fort le secteur du cinéma et en déviant la manne financière engendrée par le cinéma à d’autres fins sans penser que le cinéma doit financer le cinéma.
Tous ces problèmes vont faire perdurer la crise du cinéma africain. De la bonne santé de la distribution et de l’exploitation, dépend la production cinématographique nationale. La Communauté Economique Européenne (CEE) se joignit à l’Agence de Coopération Culturelle et Technique ACCT et à la Coopération Française à la recherche de solution adéquate pour l’Afrique, encourageant la création de plusieurs festivals consacrés aux films africains en Europe, au Canada et en Amérique latine. Plusieurs autres projets, dans la production, la distribution et l’exploitation cinématographique en Afrique, avaient vu le jour grâce à ces institutions.
En avril 2006, le Gouvernement Sud Africain, la FEPACI , l’Union Africaine et le Nepad décident de donner une nouvelle dynamique à l’industrie du cinéma en reprenant les recommandations définies en 1982 au colloque de Niamey et en créant au sein de l’Union Africaine, une Commission technique chargée du Développement de l’Industrie cinématographique en Afrique.
Quel sera donc l’avenir du cinéma en Afrique ? Un continent où tout manque, entre autres le marché de l’importation et de la distribution, les réseaux d’exploitation de films, de véritables lois protectionnistes, les infrastructures techniques, la formation professionnelle...
De ce constat, quelles stratégies, l’Afrique doit-elle découvrir pour le développement de son industrie cinématographique ? C’est la question à laquelle, notre pays, pour l’exemple qu’il avait été dans l’échiquier cinématographique africain, et l’engagement que le gouvernement a pris ces dernières temps pour relancer la cinématographie nationale, doit réellement se pencher et élaborer des stratégies adaptées au contexte dans lequel il évolue, afin de servir une fois encore d’exemple dans la création et le développement de l’industrie cinématographique en Afrique
Ousmane Ilbo Mahamane
Niger
Clap Noir
Association Clap Noir
18, rue de Vincennes
93100 Montreuil - France
Messages
1. Echec du développement de l’industrie cinématographique en Afrique, 29 octobre 2011, 20:38, par gbelia sery
tout d’abor cela part d’1 perte de confiance provoquer par nos devancier face aux autorités car l’argent avalisé par les politiques pour les premières productions a été mal utilisé en cote d’ivoire sinon les mecènes avait suivi en contruisant les salles mais les productions nationale flanche (mauvais scenario,acteur limite) resultat les films etrangers domine jusqu’a l’arrivé de la video qui confirme la mort du système mais les mecènes loue leur salle aux religieux.bisness oblige